
les hauteurs de Cize
|
UN AXE DE COMMUNICATION MAJEUR DE FRANCHISSEMENT DES PYRENEES |
|
Depuis la Préhistoire, la cordillère pyrénéenne basque n'a jamais été une barrière naturelle infranchissable. Les cols pyrénéens ont dû être empruntés par les hommes préhistoriques au cours de leurs migrations saisonnières. Les restes archéologiques mis au jour dans les Grottes d'Isturitz démontrent les liens unissant ce site de la vallée de l'Arbéroue à la région cantabrique. Le Pays de Cize présente des atouts naturels qui ont déterminé l'implantation des différentes civilisations de l'Age des Métaux, il y a plus de 3800 ans. Quatre rivières, la Nive d'Arnéguy, la Nive de Béhérobie, le Laurhibar et l'Arzuby, se rejoignent au cœur du Pays de Cize. Cette confluence donne naissance à une grande plaine alluviale, aux sols fertiles, propices à l'activité agricole. Elle est encadrée au Sud, par des montagnes couvertes de forêts et de pelouses pastorales offrant un incomparable domaine d'élevage en montagne.
|
|
|
Les très beaux dolmens, cromlechs et tumuli qui jalonnent les montagnes de Cize sont les vestiges de ces sociétés agro-pastorales. Ces populations ne vivaient pas en isolat. Les cols pyrénéens du Pays de Cize, aux altitudes modérées et à l'enneigement limité, aisément franchissables une grande partie de l'année favorisaient les échanges culturels. L'introduction et le développement de la métallurgie ainsi que l'adoption et la diffusion de rituels funéraires sont le fruit d'interactions avec des civilisations de la Péninsule Ibérique et d'Europe Centrale.
|
|
La conquête de la vallée de l'Ebre comme celle de l'Aquitaine par les troupes romaines débuta au 1er siècle av. J.C. Le monument circulaire logé sur la crête d'Urkulu peut être interprété comme le vestige exceptionnel d'un trophée-tour érigé à l'époque augustéenne, pour commémorer un succès militaire.
C'est dans cet objectif que fut réalisée la voie de Bordeaux à Astorga. Cet itinéraire est connu par un seul document antique, l'Itinéraire d'Antonin, datant probablement du dernier quart du IIIème siècle ap. J.C. Celui-ci indique 4 mansiones (villages routiers) entre Pampelune et Dax ; Carasa (Garris ou plus vraisemblablement Carresse), Imus Pyrenaeus signifiant « le bas des Pyrénées » et localisé à Saint-Jean-le-Vieux, Summus Pyrenaeus « le haut des Pyrénées » qui pourrait être situé au col d'Ibaneta et Iturissa que l'on peut identifier aux limites des communes de Burguete et d'Espinal en Navarre. Autant que vecteur économique (transports des richesses métallurgiques exploitées dans les vallées de Baïgorry et des Aldudes), cette voie était stratégique. Le camp romain de Saint-Jean-le-Vieux était la porte d'entrée, le gardien des Ports de Cize. Un camp militaire puis une station routière furent installés vers 15/1O av. J.C. Le site fut occupé presque de manière quasi continue jusqu'au passage des Vandales, au début du Veme siècle ap. J.C. |
|
|
Cette voie romaine ne tomba pas en désuétude, elle demeura au Moyen Age la voie principale de communication entre les deux versants pyrénéens.
|
|
|
De nombreuses armées arpentèrent cette voie des Ports de Cize, pour conquérir des territoires. Le premier événement qui contribua au mythe des Ports de Cize, fut la mort de Roland durant la bataille de Roncevaux en 778. Charlemagne, vint en aide au Wali de Saragosse. Il quitta Saragosse, revint à Pampelune dont il fit raser les murailles et reprit le chemin vers la France. Lors de leur passage au défilé de Roncevaux, l'arrière garde de l'armée, commandée notamment par Roland, fut décimée par les Vascons. Cette bataille et les Ports de Cize sont entrés dans la légende grâce à la Chanson de Roland, récit romancé, rédigé à la fin du XIème siècle. |
|
La ville de Saint-Jean-Pied-de-Port fut fondée à la fin du XIIème siècle à l'initiative du roi de Navarre. Elle devint rapidement la ville majeure des terres d'Outre-Ports. Pour développer l'attrait de la ville, les rois de Navarre décidèrent de dévier la voie des Ports de Cize afin que celle-ci passe par cette nouvelle ville. Son vocable évoque sa position géographique, au pied des Ports de Cize.
En 1404, Charles III, roi de Navarre écrit que Saint-Jean-Pied-de-Port est la clef de son royaume sur les ports. |
|
|
|
Située le long d'une voie
stratégique, elle bénéficia de l'attention bienveillante des rois de Navarre, qui la fortifièrent et favorisèrent
son peuplement, sa prospérité par l'octroi de privilèges.
Cette route fut empruntée par les troupes de Ferdinand le Catholique qui envahirent
le royaume de Navarre au début du XVIème. La forteresse de Saint-Jean-Pied-de-Port fut prise par les castillans en 1512.
La construction de Château Pignon à cette date, démontre que les castillans avaient saisi l'intérêt stratégique de cette route.
|
|
Cette grande route d'Espagne revêtait une fonction diplomatique. Des alliances matrimoniales se nouèrent entre les royaumes de Navarre, France et Espagne du Moyen Age au XVIIIème siècle. C'est ainsi que la jeune princesse Elisabeth de Valois qui avait été donnée en mariage à Philippe II roi d'Espagne passa par Saint-Jean-Pied-de-Port en 1560 avant d'emprunter la voie des ports de Cize pour regagner Roncevaux. Ce voyage fut très pénible, il neigeait, la voiture se renversa, des bagages se perdirent, des chevaux et même des hommes périrent. Avec de grandes difficultés le convoi arrive à Roncevaux où attendait la délégation espagnole venue accueillir la nouvelle reine.
|
|
Point de convergence des Nives et carrefour de routes qui conduisent en France, en Béarn, au Baztan par Baïgorry et à Pampelune par Roncevaux, la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port fut dès sa fondation appelée à des fonctions d'étape et de lieu d'échanges qui en firent une place commerciale majeure, réputée et dynamique. De nombreux artisans élurent domicile à Saint-Jean-Pied-de-Port. L'éventail des métiers est large, le recensement de 1413 mentionne 1 maçon, 1 pelletier, 1 tourneur, 1 tisserand, 2 couteliers, 2 peintres, 2 serruriers, 2 tonneliers, 2 couturiers, 6 forgerons, 5 muletiers, 5 bourreliers, 7 savetiers, 7 marchands, une douzaine de boucliers. Les rois de Navarre accordèrent le droit de tenir un marché hebdomadaire. Le chapitel établi sur la place Sainte- Marie (actuellement rue de l'Eglise), attirait les foules venues de Pampelune, du Béarn, de la Gascogne, du Labourd, et même d'Auvergne. Les comptes médiévaux de péages témoignent de la vitalité de ce marché au Moyen Age. |
|
|
|
Cette route des ports de Cize était empruntée, dès le Moyen Age par les pèlerins qui depuis Ostabat, Saint-Michel-le-Vieux et Roncevaux souhaitaient se rendre sur le tombeau de l'apôtre Jacques le Majeur, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le guide du pèlerin de Saint-Jacques-de Compostelle rédigé par un moine poitevin, Aimery PICAUD, au cours de la première moitié du Xllème siècle, définit quatre grands chemins de pèlerinage. Ce guide mentionne particulièrement ce trajet légendaire des Ports de Cize. |
|
Au Moyen Age, de grands ordres ecclésiastiques développèrent un réseau d'établissements pour accueillir les pèlerins. L'ordre Saint-Jean- de-Jérusalem détenait entre autre la commanderie d' Aphat Ospitalia à Saint-Jean-le-Vieux et la commanderie d'Irissarry La collégiale de Roncevaux possédait de nombreux biens le long de cette montée des Ports de Cize, parmi lesquels le prieuré-hôpital de Sainte Madeleine d'Orisson, le village de Saint-Michel et ses hôpitaux. Les Prémontrés possédaient le prieuré-hôpital de la Madeleine à Saint-Jean-le-Vieux. |
|
|
A Saint-Jean-Pied-de-Port, il y avait trois hôpitaux. Le premier était situé à l'intérieur des murailles sur la place du chapitel . Un passage voûté situé au dessus de la porte Notre-Dame relit l'hôpital à la chapelle, disposition fréquente dans les relais hospitaliers des chemins de Compostelle. Le deuxième était établi près de l' ancienne église paroissiale Sainte-Eulalie du quartier d'Ugange. Et enfin, le troisième, la chapelle Saint-Jacques jouxtait la porte Saint-Jacques. Placée au tournant du chemin des charrois de la citadelle (croix Saint-Jacques actuellement), la chapelle gênait considérablement la manœuvre des convois, elle fut détruite à la fin du XVIII siècle. La fondation et le développement de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port furent conditionnés par une situation géographique favorable, au pied des Ports de Cize, le long d'une voie historique majeure de franchissement des Pyrénées. Alain ZUAZNABAR-INDA
|
Quelques photos complémentaires

la croix d'Urdanasburu

Leïzar Atheka
|
|
|

|
 cromlechs en pays de Cize
cromlechs en pays de Cize Tour d'Urkulu
Tour d'Urkulu
 Imus pyrenaeus
Imus pyrenaeus Stèle de Roland à Roncevaux
Stèle de Roland à Roncevaux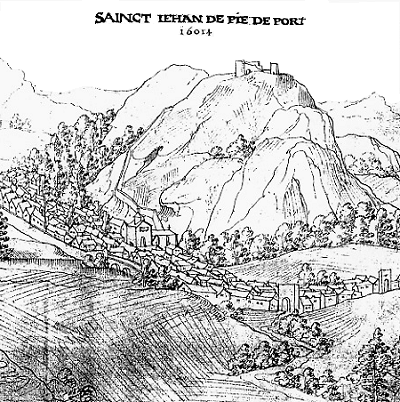 St Jean pied de Port vu par de Wiert
St Jean pied de Port vu par de Wiert la redoute de Chateau pignon et le rocher de Zerkupé
la redoute de Chateau pignon et le rocher de Zerkupé St Jean Pied de Port
St Jean Pied de Port
 Pèlerin de Compostelle
Pèlerin de Compostelle



